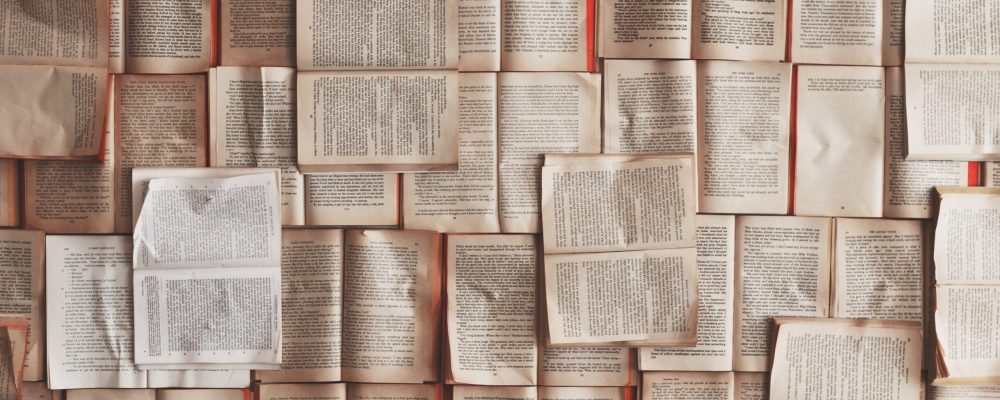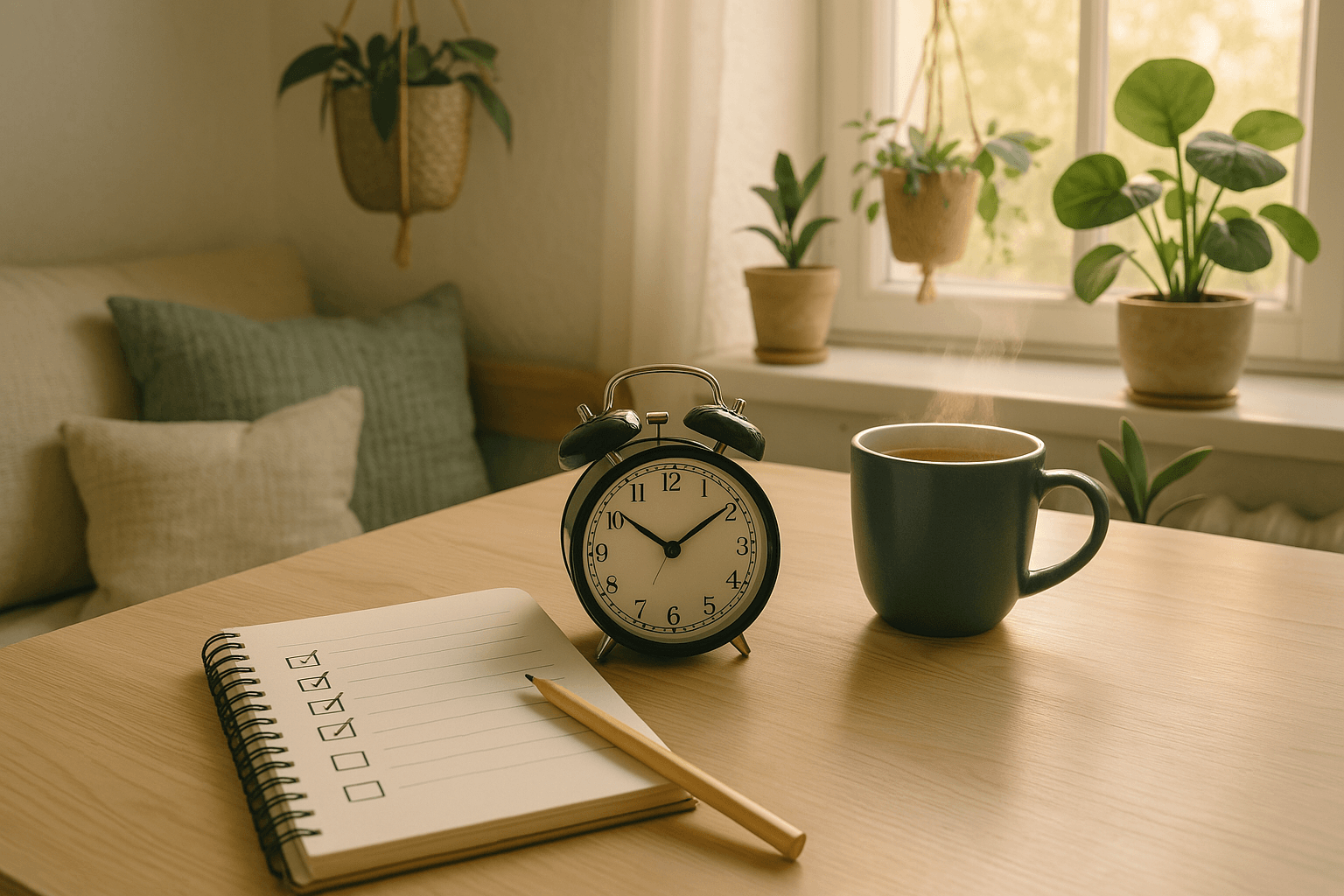Pourquoi certaines personnes semblent-elles accomplir en quelques heures ce qui prend une journée entière à d’autres ? La productivité n’est pas qu’une question de volonté ou de discipline. Elle repose sur des mécanismes psychologiques et organisationnels bien établis, que l’on retrouve dans différentes lois du temps et de l’efficacité.
De la loi de Pareto, qui montre que 20 % de nos efforts produisent 80 % des résultats, à la loi de Parkinson, qui explique pourquoi une tâche s’étend toujours au temps qu’on lui accorde, ces principes aident à mieux structurer son travail et à éviter les pièges de la procrastination et du surmenage.
Dans cet article, nous allons explorer 11 lois incontournables pour mieux gérer votre temps, optimiser vos journées et travailler avec plus de sérénité et d’efficacité.
Les 4 premières lois (lois de Pareto, Carlson, Newton, et Illich) permettent d’orienter notre travail : trier ce que nous devons faire, et comment le faire. Les 4 suivantes (lois de Parkinson, Douglas, Murphy et Hofstadter) indiquent les écueils à éviter. Et les 3 dernières (lois de Laborit, Fraisse, et Swoboda-Fliess-Teltscher) expliquent des fonctionnements du cerveau dont il faut tenir compte pour être productif.
Pour commencer, voici les 4 premières lois, qui sont les plus utiles, et qui permettent d’orienter notre façon de travailler.
![]()
1. Loi de Pareto ou 80/20
Se concentrer sur l’essentiel pour des résultats maximaux
« 80% de nos résultats sont produits par 20% de nos efforts »
C’est la loi de productivité la plus connue, et aussi celle qui peut avoir le plus grand impact sur votre productivité.
Principe : La loi de Pareto, aussi appelée règle des 80/20, stipule que 80 % des résultats proviennent de 20 % des efforts. Ce principe, observé dans de nombreux domaines, montre que l’efficacité ne repose pas sur la quantité de travail, mais sur la pertinence des actions menées.
Pourquoi cette loi est essentielle en productivité ?
Beaucoup de personnes s’épuisent en voulant tout faire, alors qu’une minorité de tâches génère l’essentiel de l’impact. Appliquer la loi de Pareto permet de gagner du temps, d’éliminer le superflu et de se concentrer sur ce qui fait réellement avancer les choses.
Comment l’appliquer ?
- Identifiez vos 20 % les plus productifs : Quels sont les clients, tâches ou projets qui apportent le plus de résultats ?
- Réduisez ou déléguez le reste : Diminuez le temps consacré aux tâches secondaires.
- Priorisez votre travail : Chaque matin, posez-vous la question : Quelle est l’action la plus efficace que je peux faire aujourd’hui ?
En appliquant ce principe, on évite la dispersion et on maximise son impact, sans forcément travailler plus.

2. Loi de Carlson
Mieux vaut une tâche continue que fragmentée
« Un travail réalisé en une fois prend moins de temps et d’énergie que lorsqu’il est réalisé en plusieurs fois »
Principe : Selon Sune Carlson, économiste suédois, une tâche effectuée en continu prend moins de temps et d’énergie que si elle est réalisée en plusieurs sessions entrecoupées d’interruptions.
Pourquoi c’est important ?
Chaque fois que vous êtes interrompu dans une tâche, votre cerveau doit faire un effort pour se reconnecter à ce que vous faisiez. Ce phénomène, appelé coût de basculement cognitif, réduit votre concentration et vous fait perdre du temps.
Exemple concret :
Imaginez que vous rédigez un rapport, mais que toutes les dix minutes, vous consultez vos emails ou répondez à des notifications. Chaque retour sur votre rapport vous demande un effort de recontextualisation, ce qui allonge inutilement le temps de travail.
Comment l’appliquer ?
- Regroupez les tâches similaires (ex. répondre aux emails à des moments précis plutôt que toute la journée).
- Créez des blocs de travail ininterrompus pour vos tâches importantes (ex. 60-90 minutes sans distractions).
- Coupez les notifications et signalez à votre entourage que vous êtes en mode concentration.
En appliquant la loi de Carlson, vous gagnerez en efficacité et en sérénité en évitant la dispersion mentale.

3. Loi du mouvement de Newton
L’inertie du travail
« Tout corps persévère dans l’état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n’agisse sur lui, et ne le contraigne à changer d’état »
Le physicien très connu Isaac Newton est l’auteur de cette loi de la physique.
Principe : La première loi de Newton, aussi appelée principe d’inertie, s’applique aussi à notre productivité :
- Un travail en cours a tendance à se poursuivre tant qu’aucune force extérieure ne vient l’arrêter.
- Une tâche non commencée reste à l’arrêt, sauf si une impulsion initiale la met en mouvement.
Pourquoi c’est important ?
L’une des principales difficultés en productivité est de se lancer. Plus une tâche est reportée, plus elle semble difficile. À l’inverse, une fois plongé dedans, il est souvent plus facile de continuer.
Exemple concret :
Vous devez rédiger un article, mais vous procrastinez. Pourtant, si vous vous forcez à écrire juste une phrase, vous entrez dans la dynamique du travail et avez plus de chances de continuer.
Comment l’appliquer ?
- Utilisez la règle des 2 minutes : commencez une tâche pendant 2 minutes, sans pression. Une fois lancé, l’inertie vous aidera à continuer.
- Créez des routines de démarrage (ex. allumer une bougie, mettre une playlist focus, préparer son espace de travail).
- Évitez les interruptions au début d’une tâche, car elles risquent de casser votre élan.
La loi de Newton nous rappelle que se mettre en mouvement est la clé pour éviter la procrastination et avancer efficacement.

4. Loi d’Illich
Travailler trop nuit à la productivité
Après un certain temps, la productivité tend à décroitre, voire atteindre des valeurs négatives »
Principe : Plus vous travaillez longtemps, moins vous êtes efficace. Au-delà d’un certain seuil, la fatigue et la baisse de concentration réduisent la qualité de votre travail.
Pourquoi c’est important ?
Nous avons tendance à croire que travailler plus signifie accomplir plus. Pourtant, au bout d’un certain temps, notre cerveau sature, les erreurs se multiplient et notre rendement diminue.
Exemple concret :
Un créateur de contenu travaille 10 heures d’affilée sur un projet. Au début, il est productif, mais au fil des heures, il se fatigue, perd du temps sur des détails et fait des erreurs qu’il devra corriger plus tard.
Comment l’appliquer ?
- Fixez-vous des limites de temps : au lieu de travailler sans fin, définissez des plages horaires adaptées à votre niveau d’énergie.
- Intégrez des pauses régulières : testez des méthodes comme la technique Pomodoro ou des pauses actives pour recharger votre concentration.
- Repérez votre seuil de rendement : observez à partir de quand votre efficacité commence à baisser et ajustez votre rythme de travail.
La loi d’Illich nous rappelle que travailler plus ne signifie pas toujours travailler mieux. L’essentiel est d’optimiser son temps pour rester performant sans s’épuiser.

5. Loi de Parkinson
Le travail s’étend pour occuper tout le temps disponible
« Chaque tâche s’étale de façon à occuper tout le temps disponible pour son achèvement »
Principe : Plus on dispose de temps pour une tâche, plus cette tâche prend du temps.
Pourquoi c’est important ?
Si vous vous donnez une journée entière pour rédiger un rapport qui pourrait être bouclé en trois heures, vous allez inconsciemment étirer le travail pour remplir ce temps imparti. Résultat : perte de temps, dispersion et baisse d’efficacité.
Exemple concret :
Imaginez que vous devez répondre à vos emails. Si vous vous donnez une matinée complète, vous risquez de traîner, de reformuler des messages inutiles ou de vous laisser distraire. En revanche, si vous vous imposez 30 minutes, vous irez droit au but et serez bien plus efficace.
Comment l’appliquer ?
- Fixez-vous des délais précis et réalistes : attribuez un temps limité aux tâches pour éviter qu’elles ne s’éternisent.
- Utilisez la contrainte positive du temps : transformez un travail de 4 heures en un sprint de 2 (ou 3) heures bien structuré.
- Expérimentez le time blocking : programmez des plages horaires dédiées aux tâches importantes pour éviter qu’elles ne s’étirent inutilement.
Moins de temps = plus d’efficacité : La loi de Parkinson nous enseigne que se fixer des limites claires permet de mieux utiliser son temps et d’éviter la procrastination.


6. Loi de Douglas
Plus il y a d’espace, plus on le remplit
Principe : Cette loi est l’équivalent spatial de la loi de Parkinson. Tout espace disponible a tendance à être occupé, souvent de manière excessive.
Pourquoi c’est important ?
Dans le domaine de la productivité, cela s’applique directement à notre espace de travail. Un bureau vide ne le reste jamais longtemps : on y accumule des papiers, fournitures, objets décoratifs, et peu à peu, cet encombrement physique se transforme en pollution mentale. Chaque élément dans notre champ de vision capte une fraction de notre attention, générant des distractions invisibles mais bien réelles.
Exemple concret :
- Vous commencez avec un bureau bien rangé, mais au fil des jours, il se remplit de documents, post-it, carnets, tasses de café…
- Plus vous avez d’étagères, plus vous les remplissez de livres et dossiers, même si vous ne les consultez jamais.
- Un grand sac ou une grande valise finit souvent par être rempli jusqu’au maximum, même si vous partez seulement pour un week-end.
Comment l’appliquer ?
- Ranger et épurer régulièrement : Désencombrez votre bureau pour libérer de l’espace mental et limiter les distractions.
- Limiter les surfaces disponibles : Moins vous avez d’espace pour accumuler, plus vous serez sélectif sur ce que vous conservez.
- Organiser intelligemment : Rangez dans des tiroirs tout ce qui n’est pas nécessaire immédiatement et ne gardez sur votre bureau que l’essentiel : ordinateur, écran, souris et quelques objets inspirants.
Un bureau épuré = un esprit plus clair : Appliquer la loi de Douglas, c’est choisir un cadre qui favorise la concentration et l’efficacité.
![]()
7. Loi de Murphy
Tout ce qui peut mal tourner finira par mal tourner
Principe : La loi de Murphy énonce que si un problème peut survenir, il surviendra tôt ou tard. Appliquée à la productivité, cela signifie que les imprévus sont inévitables, qu’il s’agisse d’un bug informatique, d’une réunion qui s’éternise ou d’un retard dans un projet.
Pourquoi c’est important ?
Beaucoup de personnes planifient leurs journées comme si tout allait se dérouler parfaitement. Mais en réalité, un planning trop rigide s’effondre dès le premier imprévu. Les tâches prennent souvent plus de temps que prévu, des urgences surviennent, et la concentration fluctue. Ne pas anticiper ces aléas conduit à du stress et une impression de toujours courir après le temps.
Exemples concrets :
- Vous programmez une tâche essentielle à 9h, mais votre ordinateur décide de faire une mise à jour de 15 minutes.
- Vous prévoyez de finir un rapport en une heure, mais vous réalisez que vous n’avez pas toutes les informations nécessaires.
- Vous partez en avance pour un rendez-vous… mais un embouteillage imprévu vous met en retard.
Comment l’appliquer ?
- Prévoir du temps tampon : Intégrez des marges dans votre emploi du temps pour absorber les imprévus. Par exemple, ajouter 20 ou 25 % de temps supplémentaire aux tâches longues.
- Prioriser les tâches essentielles : Si tout ne peut pas être fait, mieux vaut que les tâches les plus importantes soient accomplies en premier.
- Avoir des plans de secours : Toujours prévoir une alternative : une copie de sauvegarde de vos fichiers, une liste de tâches de secours en cas d’interruption, ou encore un plan B en cas d’annulation d’un rendez-vous.
Accepter l’imprévu, c’est mieux le gérer : La loi de Murphy nous rappelle que l’anticipation et la flexibilité sont des clés essentielles pour une productivité sereine. Plutôt que de lutter contre les aléas, mieux vaut apprendre à naviguer avec eux.

8. Loi de Hofstadter
Un projet prend toujours plus de temps que prévu, même en l’anticipant
« Il faut toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte de la Loi de Hofstadter »
Principe : La loi de Hofstadter nous met en garde contre une tendance universelle à sous-estimer le temps nécessaire pour accomplir une tâche ou un projet. Même en anticipant d’éventuels retards, les choses prennent souvent plus de temps que prévu.
Pourquoi c’est important ?
Nous avons naturellement une vision trop optimiste de notre capacité à accomplir une tâche rapidement. Nous oublions souvent les imprévus, les interruptions, ou même la difficulté réelle du travail. Résultat : nous nous retrouvons sous pression, en retard, et parfois même découragés.
Exemples concrets :
- Vous pensez terminer un rapport en deux heures… mais il vous en faut finalement trois, car vous devez chercher des informations supplémentaires.
- Vous planifiez la refonte d’un site web en un mois… mais entre les retours clients, les bugs et les révisions, le projet s’étale sur trois mois.
- Vous prévoyez d’écrire un article en une matinée… mais l’inspiration ne vient pas immédiatement, et la relecture prend plus de temps que prévu.
Comment l’appliquer ?
- Toujours prévoir plus de temps que ce que l’on estime : Un bon réflexe est d’ajouter 20 à 25 % de marge au temps que vous pensez nécessaire.
- Découper un projet en petites étapes lors de la conception : Cela permet de mieux évaluer la charge de travail et d’éviter les surprises. Mais une fois le projet lancé, il est préférable d’enchaîner les tâches sans les morceler davantage, conformément à la loi de Carlson, afin de rester efficace et concentré.
- Tenir un journal de ses tâches : En notant combien de temps prennent réellement vos activités, vous affinez vos futures estimations et devenez plus précis.
- Accepter l’imprévu : Au lieu de s’énerver contre les retards, les voir comme une opportunité d’ajuster son organisation et d’améliorer ses prévisions à l’avenir.
Une meilleure planification pour une meilleure sérénité : Comprendre que tout prend plus de temps que prévu évite la frustration et permet d’ajuster son emploi du temps de manière plus réaliste. En intégrant cette loi à votre gestion du temps, vous réduisez le stress et gagnez en efficacité.

9. Loi de Laborit
Notre cerveau préfère le plaisir immédiat aux efforts durables
« Le cerveau recherche la satisfaction immédiate et fuit la difficulté »
Principe : Notre cerveau est naturellement programmé pour éviter la difficulté et rechercher la satisfaction immédiate. Cette tendance, héritée de l’époque des chasseurs-cueilleurs, nous poussait à assurer notre survie en privilégiant des actions immédiates comme chercher de la nourriture ou fuir un danger.
Aujourd’hui, bien que notre quotidien soit bien différent, notre cerveau fonctionne toujours de la même façon. Il nous incite à nous tourner vers ce qui est facile et agréable – consulter nos e-mails, faire défiler les réseaux sociaux, ranger notre bureau – plutôt que d’attaquer une tâche exigeante dont les bénéfices ne seront visibles que plus tard.
Pourquoi c’est un problème ?
Lorsque nous cédons systématiquement à cette tendance, nous risquons d’accumuler du travail en retard, d’avoir du mal à avancer sur nos objectifs à long terme, et de ressentir une frustration liée à la procrastination.
Comment en tirer parti au lieu de lutter contre ?
La solution n’est pas de lutter en permanence contre notre cerveau, mais de travailler avec lui. Plutôt que de forcer l’accomplissement des tâches difficiles dès le matin (« Eat the Frog »), il peut être plus efficace de rentrer progressivement dans un état de travail en commençant par des tâches plus simples ou plus engageantes.
Stratégies adaptées à la slow productivité :
- Créer un enchaînement naturel : Commencer par une tâche légère pour se mettre en mouvement, puis glisser progressivement vers des tâches plus complexes.
- Associer effort et satisfaction : Relier les tâches importantes à une forme de récompense ou de satisfaction immédiate (exemple : un bon café, une ambiance agréable, un rituel motivant).
- Optimiser son énergie : Identifier les moments de la journée où l’énergie est naturellement plus élevée pour s’attaquer aux tâches les plus exigeantes.
- Miser sur les habitudes : Une habitude bien ancrée demande peu d’effort mental et contourne cette résistance naturelle à la difficulté.
Travailler avec son cerveau, pas contre lui : Plutôt que de culpabiliser face à notre tendance naturelle à éviter l’effort, il est plus intelligent d’en tenir compte et d’adapter notre manière de travailler en conséquence. C’est ainsi que la slow productivité permet d’être efficace sans aller à l’encontre de notre fonctionnement naturel.

10. Loi de Fraisse
1 heure n’est pas toujours égale à 1 heure
Principe : Le temps est une donnée objective… mais notre perception du temps, elle, est totalement subjective. Une même durée peut nous sembler longue ou courte selon le contexte, notre niveau d’énergie et notre engagement dans une tâche.
Pourquoi c’est important ?
Nous avons tendance à croire que nous pouvons remplir nos journées avec des tâches de durées équivalentes, comme si 1 heure de travail demandait toujours le même effort. En réalité, notre ressenti du temps varie énormément :
- Un travail passionnant passe en un éclair.
- Une tâche ennuyeuse ou complexe semble interminable.
- Une heure de travail en pleine forme est bien plus productive qu’une heure de travail en fin de journée, fatigué.
Cette distorsion du temps influence directement notre productivité. Nous surestimons souvent ce que nous pouvons faire en une journée et sous-estimons ce que nous pouvons accomplir sur plusieurs semaines.
Comment en tirer parti pour mieux travailler ?
- Prendre en compte notre perception du temps
Plutôt que d’organiser nos journées en blocs de temps rigides, mieux vaut adapter nos tâches à notre niveau d’énergie et d’engagement. Par exemple, garder les tâches exigeantes pour les moments où nous sommes naturellement plus concentrés, et réserver les tâches répétitives pour les moments de baisse d’énergie.
- Utiliser des unités de temps qui ont du sens
Plutôt que de bloquer « 1 heure pour écrire », il peut être plus efficace de définir des objectifs basés sur l’avancée du travail (« Rédiger l’introduction et la première partie »). Cela permet de s’adapter à la perception du temps plutôt que de la subir.
- Varier les rythmes pour éviter la monotonie
Travailler sur une seule tâche pendant une longue période peut donner l’impression que le temps s’étire. En alternant entre différentes activités ou en intégrant des pauses, on joue avec la perception du temps pour rester efficace plus longtemps.
L’enseignement de la slow productivité :
Plutôt que de vouloir caser le maximum de tâches dans un temps limité, la slow productivité nous invite à prendre en compte notre ressenti du temps et à travailler en fonction de nos cycles d’énergie et de motivation. C’est ainsi que l’on peut réellement travailler mieux, sans s’épuiser.

11. Loi de Swoboda-Fliess-Teltscher
Nos performances fluctuent selon des cycles biologiques
« Nos rythmes biologiques et notre environnement influencent notre productivité »
Principe : Notre corps et notre cerveau ne fonctionnent pas de manière linéaire. Nos capacités de concentration, d’énergie et de motivation fluctuent selon des cycles biologiques.
Pourquoi c’est important ?
Nous avons tendance à planifier nos journées comme si nous étions capables de maintenir un niveau de performance constant du matin au soir. Pourtant, notre productivité suit des rythmes naturels :
- Des variations d’énergie au fil de la journée (certains sont plus productifs le matin, d’autres le soir).
- Des cycles de vigilance et de fatigue influencés par le sommeil et l’alimentation.
- Des périodes de forte motivation suivies de phases de creux plus ou moins marquées.
Ne pas tenir compte de ces variations peut nous pousser à forcer lorsque notre cerveau n’est pas en état optimal, ce qui entraîne frustration et inefficacité.
Comment en tirer parti pour mieux travailler ?
✔ Identifier ses propres cycles
Plutôt que de suivre un emploi du temps rigide, observez à quels moments de la journée vous êtes naturellement plus concentré et énergique. Cela vous permettra d’adapter vos tâches en fonction de votre rythme personnel.
✔ Optimiser son emploi du temps
- Réservez les tâches complexes aux moments où vous êtes le plus alerte.
- Regroupez les tâches routinières et simples pendant les phases de moindre énergie.
- Prévoyez des pauses stratégiques pour éviter d’accumuler de la fatigue inutilement.
✔ Éviter de lutter contre ses rythmes naturels
Si vous remarquez qu’un moment de la journée est systématiquement difficile (baisse d’énergie en début d’après-midi, par exemple), inutile d’essayer de forcer : accordez-vous une pause ou effectuez une tâche plus légère.
Ce que nous montre la slow productivité :
Plutôt que de vouloir être performant à tout prix à chaque instant, la slow productivité encourage une approche plus respectueuse de nos rythmes biologiques. C’est en harmonisant notre travail avec les besoins de notre corps, plutôt qu’en luttant contre lui, que nous gagnons en efficacité et en sérénité.
Conclusion – Mieux comprendre le temps pour mieux l’utiliser
Notre rapport au temps influence directement notre efficacité et notre bien-être. Les 11 lois que nous avons explorées ne sont pas de simples concepts théoriques, mais des réalités qui façonnent notre manière de travailler et de nous organiser.
Plutôt que de lutter contre ces lois, la clé est d’en tirer parti :
✔ Prioriser intelligemment (Loi de Pareto, Loi du mouvement de Newton).
✔ Gérer son temps et son espace efficacement(Loi de Carlson, Loi de Douglas, Loi de Parkinson).
✔ Anticiper les obstacles et ajuster ses attentes (Loi de Murphy, Loi de Hofstadter).
✔ Composer avec nos rythmes naturels et notre fonctionnement cérébral (Loi de Laborit, Loi de Fraisse, Loi de Swoboda-Fliess-Teltscher).
Plutôt que de chercher à être productif coûte que coûte, la slow productivité nous invite à être plus stratégiques et à travailler en respectant notre énergie et nos cycles naturels.
En appliquant ces principes au quotidien, on apprend à mieux gérer son temps, à réduire le stress et à avancer sereinement vers ses objectifs.